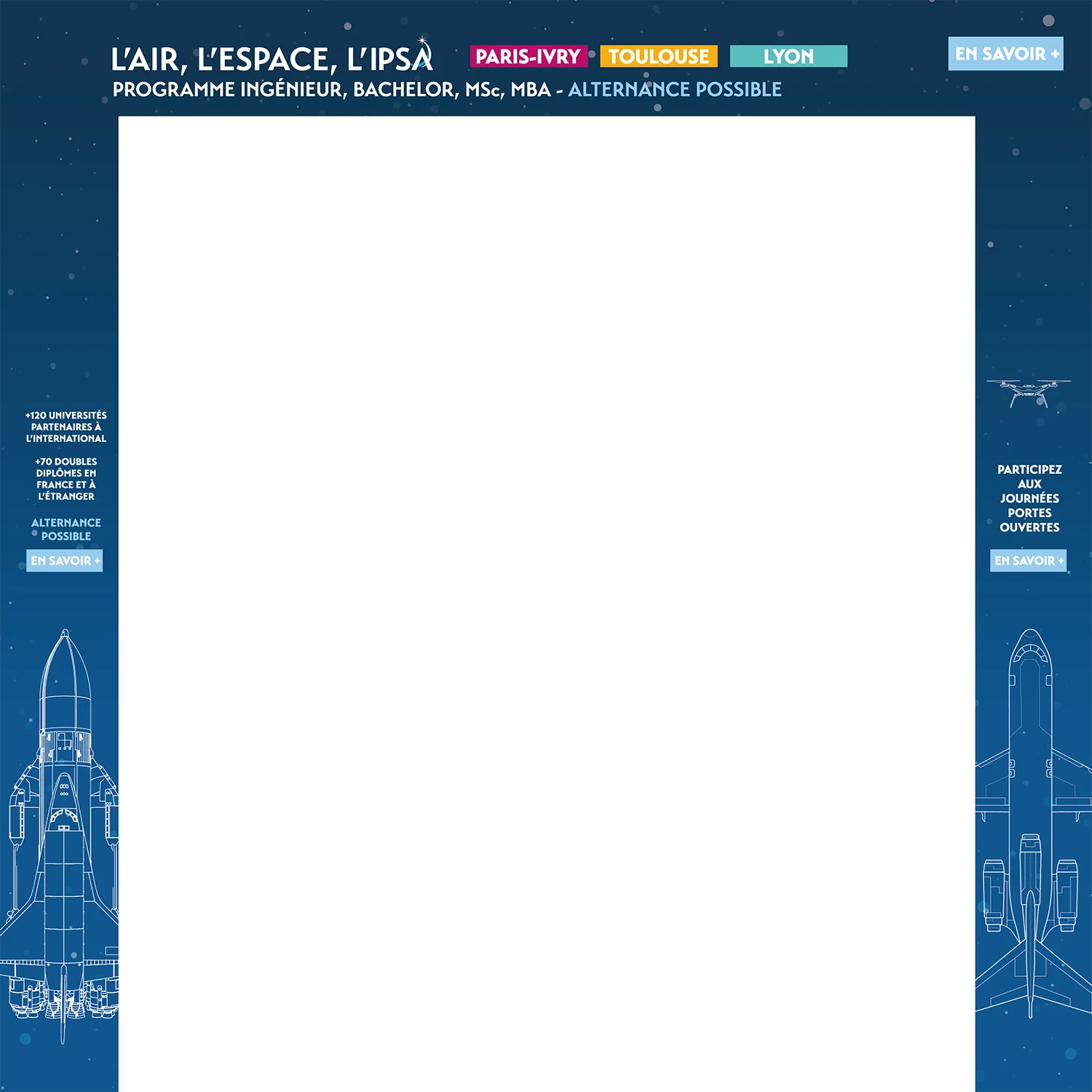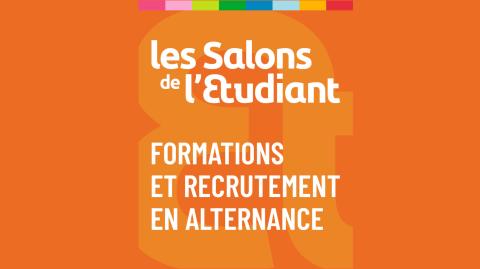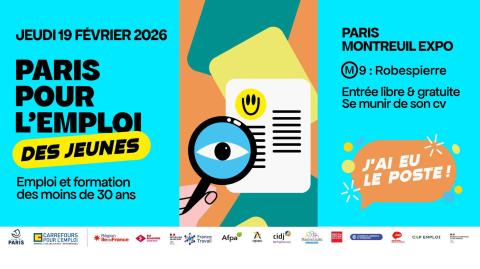Récits Handicap dans la famille : comment les frères et sœurs vivent-ils cette cohabitation ?
En bref
- Environ 3,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans vivent à domicile avec un handicap et dont le quotidien retentit sur les frères et sœurs.
- Se construire et bâtir une relation fraternelle équilibrée impliquent un processus d’acceptation et de différenciation.
- Les fratries développent une sensibilité à la différence qui les accompagne jusqu’à l’âge adulte.
Grandir au sein d’une fratrie atypique
« Quand Antoine nous regarde droit dans les yeux avec un grand fou rire, ça vaut tout l’or du monde et ça apaise tout. » Adolescent, le grand frère de Lucie Hodiesne Darras, porteur d’une forme sévère d’autisme qui le prive de la parole, gère difficilement certaines émotions comme la frustration ou la colère. Si bien qu’il pouvait « faire un câlin à ma mère et, la minute suivante, entrer en conflit assez violent avec elle », se remémore la photographe de 30 ans. Une situation déstabilisante pour l’enfant qu’elle était alors. Pour autant, et en dépit de la réalité complexe qui l’a vue grandir, la jeune femme ne changerait rien de son histoire fraternelle et familiale. Au contraire, elle s’estime chanceuse d’avoir vécu cet apprentissage de « la résilience, de la solidarité et de l’entraide ». Elle garde précieusement en mémoire les bons moments. « Mon frère m’a appris à apprécier les petites choses du quotidien : partager un bon repas avec les gens que l’on aime, se promener dans la nature, être connecté à l’essentiel. » Néanmoins, cette philosophie, elle l’acquiert avec le temps. Car, appartenir à une fratrie où le handicap s’est immiscé représente une triple gageure : se construire soi-même, tisser une relation équilibrée avec ce frère ou cette sœur différents, et se projeter dans l’avenir. Aussi, la psychologue clinicienne et maîtresse de conférences Clémence Dayan assimile ce processus à « une expérience toujours marquante, souvent teintée de douleur ». Le principal risque ? En venir à taire ses émotions et ses besoins, tout en composant avec des sentiments contradictoires, entre amour et rejet. Un rejet du handicap qui est d’abord et surtout celui de la société.
Tristesse, colère : la bataille des émotions
« Prendre la défense de mon frère, c’était risquer de perdre ma place au monde. » Par ces mots très forts, l’autrice et podcasteuse Léa Hirschfeld, 30 ans, résume l’ambivalence dans laquelle le regard d’autrui plonge les fratries confrontées au handicap. En effet, « avant l’âge de 5-6 ans, les enfants se montrent moins sensibles à la différence et au handicap tel qu’il est perçu par la société, à savoir comme une déficience », décrypte Clémence Dayan. Mais, une fois franchi ce cap, les frères et sœurs observent, désemparés, la mise à l’écart de l’enfant différent : « Quand j’ai compris que la façon d’être d’Anton s’apparentait à un problème pour les autres, confie Léa Hirschfeld, son trouble neurologique était devenu un problème aussi pour moi. » D’une nature sociable et curieuse du monde, elle refuse alors d’être exclue. De son côté, Lucie Hodiesne Darras subit le harcèlement scolaire : « Ton frère est débile, tu es débile », entend-elle. Des propos qui la laissent démunie, car elle ne dispose pas encore des clés pour soutenir son frère. S’il fallait le préciser, l’amour demeure pleinement présent, quoique bousculé, de temps à autre, par des pensées sombres. Éléonore Cotman, directrice d’un service d’action sociale en Belgique, en a fait l’expérience, aussi déconcertante que rude, avec sa sœur, porteuse d’une trisomie 14 : « Plus jeune, je me disais parfois que ce serait plus facile sans elle ». Une dualité qui la traversait avec fracas, sans comprendre « comment il est possible à la fois d’aimer très profondément et de ressentir quelque chose d’aussi violent », ajoute la trentenaire. Une colère légitime, dirigée en réalité contre le handicap, ce qu’elle comprend à travers ses séances chez le psychologue qu’elle consulte à partir de l’âge de 16 ans. Une prise en charge telle « une bouée de sauvetage », quoique tardive, estime-t-elle, aujourd’hui.
Endosser le rôle de l’enfant qui va bien
C’est la clairvoyance de son professeur de CP qui amène Lucie Hodiesne Darras à extérioriser son mal-être. Si, à la maison, « on peut se dire les choses et parler librement », elle s’évertue à relativiser le harcèlement subi, au point que sa confiance en elle s’étiole. Alertés par l’enseignant, ses parents instaurent un suivi psychologique comprenant la participation à un atelier créatif hebdomadaire, qu’elle qualifie de bulle de respiration. Fréquemment, « les frères et sœurs se construisent avec le souci de ne pas ajouter de difficultés aux parents, analyse la psychologue Clémence Dayan, dont les travaux portent sur le handicap dans la fratrie. Ils compensent en devenant " l’enfant qui va bien ", s’appliquent à l’école, se rendent utiles à la maison, aident le frère ou la sœur porteurs de handicaps ». Chez ces enfants, le sentiment d’impuissance face à l’injustice du handicap entraine des interrogations intérieures : « Est-ce de ma faute ? », « Pourquoi je n’ai pas de handicap ? », « Peut-être ai-je un handicap qui ne se voit pas ? ». Autant de questions qui appellent des réponses, afin de dissiper des croyances telles que : « Ce que je vis n’est pas aussi important que ce que vit mon frère/ma sœur ». Une posture délétère sur le plan de la construction psychique. C’est pourquoi « l’accès à un espace d’écoute et de parole s’avère essentiel », insiste Clémence Dayan. Et si un lieu permettait la rencontre de ces fratries ? L’idée a germé, il y a douze ans, dans la tête d’Éléonore Cotman et de son amie Élise Petit, dont deux des frères sont atteints d’une myopathie. Ainsi nait, à Bruxelles, l’association FratriHA, qui organise notamment des groupes de parole sous forme d’ateliers permettant aux enfants de s’exprimer tout en jouant. « Ces rencontres entre pairs, auxquelles ne participent ni les parents ni l’enfant en situation de handicap, leur procurent du réconfort », rapporte la psychologue Maëlle Delhaise, qui encadre ces parenthèses de répit. Et pour cause, ils se sentent compris et moins seuls.
Vivre entre deux mondes
Il est ardu de parvenir à trouver sa place dans une configuration où l’enfant en situation de handicap concentre nécessairement l’attention des parents. Il n’est pas simple non plus de construire une relation fraternelle équilibrée. Dans la tête de l’enfant qui va bien, les rôles s’inversent parfois. « Je savais parler, lire, courir… avant Anton », se souvient Léa Hirschfeld devenue la « grande petite sœur ». Elle poursuit : « Quand je devenais un peu trop maîtresse d’école, à vouloir lui apprendre plein de choses, mes parents me rappelaient que ce n’était pas mon rôle ». Une question surgit alors : comment créer des moments de complicité quand on navigue entre deux mondes, celui de la maison et celui de l’extérieur, parfois hostile, mais vital pour se construire en tant qu’individu ? « Mes parents restaient attentifs à ce que mon frère et moi ayons nos propres activités chacun, et on partait en vacances en famille, dans des cadres qui convenaient à Mathilde », se souvient Éléonore Cotman. Chez Lucie Hodiesne Darras, le rire et la dérision allègent un quotidien complexe. Antoine « décroche du film au bout de quelques minutes », rendant impossibles les sorties au cinéma ? Qu’à cela ne tienne ! « Antoine aime l’eau et les piscines, il apprécie aussi les sensations fortes, on allait ensemble faire des tours de manèges au parc d’attractions. » Avec l’expérience, elle apprend à le comprendre et à tisser des liens très forts, fusionnels. Pourtant, la communication avec ce frère qui ne parle pas, mais comprend et ressent tout, passe par le non-verbal, la gestuelle, le regard. « Lorsqu’il a faim, il tend son assiette ; pour signifier qu’il veut sortir, il apporte ses chaussures », raconte la photographe. Cependant, dans certaines fratries, le quotidien, rythmé par le handicap, insuffle l’envie de quitter le cocon familial.
S’éloigner pour mieux se retrouver
La période charnière de l’adolescence exacerbe le handicap. « Quand je sortais faire du shopping avec mes amies, Mathilde se mettait en colère, consciente des limites imposées par son handicap », évoque Éléonore Cotman. Elle s’installe en colocation à 18 ans, une décision à l’effet « libérateur ». « Progressivement, je conçois que j’ai le droit de me construire en tant que personne à part entière et de mener ma propre vie, explique la Bruxelloise, tout en conservant un lien avec ma famille, parce qu’on s’aime toujours très fort. » Ainsi, les relations avec ses proches gagnent en harmonie. L’envie de partir saisit également Léa Hirschfeld, adolescente rebelle en quête « d’oxygène » : scolarité en internat, retour à la maison, puis nouveau départ à 17 ans pour suivre ses études supérieures à Montréal. S’ensuit, à la vingtaine, le sentiment d’être passée à côté de la relation avec son frère. « On ne sait pas trop quoi faire ensemble avec Anton, on ne se connaît pas finalement, car nous n’avons pas été suffisamment encouragés à passer du temps ensemble à l’extérieur de la maison », regrette-t-elle. Ce sera chose faite lorsqu’elle séjourne avec lui dans un camp d’été aux États-Unis, qui réunit des personnes valides comme porteuses de handicaps. Frère et sœur se (re)découvrent, s’énervent parfois. Puis, le confinement accélère ces retrouvailles dans l’appartement de l’enfance : « Je réalise avec soulagement qu’un quotidien apaisé avec Anton est possible, il faut dire aussi que j’ai 25 ans et que j’ai mûri. Je pense aussi à l’avenir et au fait que j’aurai un jour la charge de mes parents vieillissants et celle de mon frère ».
Se projeter dans l’avenir
Antoine, le grand frère de Lucie Hodiesne Darras, vit en foyer médicalisé depuis l’âge de 18 ans, il partage une petite maison avec huit personnes. Ses parents se sont battus pour cette place afin que leur fille n’endosse pas seule cette lourde responsabilité à l’avenir et qu’elle puisse privilégier les moments qualitatifs avec lui. « Il s’y plaît au point que lorsqu’il rentre le week-end, le départ du lundi matin est assez expéditif, sourit la jeune femme, il semble pressé de retourner à ses activités et à sa routine ». Mathilde vit actuellement avec son fiancé, porteur d’une trisomie 21, dans leur appartement. Une fondation, créée par ses parents, et à laquelle participent également sa sœur, son frère, et quelques proches, veillera à son bien-être. « Le jour où mes parents ne seront plus là, cette fondation permettra de gérer les besoins de ma sœur, sur le plan financier notamment », apprécie Éléonore Cotman. Grandir auprès d’un frère ou d’une sœur porteurs de handicaps façonne une sensibilité à la différence et le besoin de s’entourer de personnes partageant cette même valeur. « Mathilde est incluse dans mes plans de vie à long terme, déclare Éléonore Cotman. Avec mon compagnon, nous envisageons de créer une chambre pour elle dans les travaux de notre maison pour l’accueillir lorsqu’elle viendra nous rendre visite ». Lucie Hodiesne Darras a entrepris un projet photographique avec son frère pour immortaliser leur histoire et la partager : « Antoine a très vite compris que c'était ma façon de communiquer, et c'est une manière aussi pour lui de s'exprimer. Un jour, il a vu que sa silhouette faisait une ombre portée sur le mur. Il s'est arrêté, il m'a regardé droit dans les yeux avec un grand sourire, j'ai compris qu'il voulait que je le prenne en photo. » Léa Hirschfeld a créé le podcast Décalés, un terme qu’elle préfère à celui de « handicapé », dans lequel elle donne la parole à ceux qui sont concernés. Elle retrace aussi son histoire avec Anton, devenu un peintre représenté par une galerie, dans un roman intitulé Zeno. En parallèle de son travail auprès des personnes en difficulté sociale, Éléonore Cotman poursuit son engagement bénévole au sein de l’association FratriHA qu’elle rêve de voir essaimer un peu partout pour davantage prendre en compte le vécu des frères et sœurs. À son tour, Lucie Hodiesne Darras propose, en lien avec une association, des ateliers de photographie pour offrir aux frères et sœurs d’enfant porteur de handicaps une bulle de respiration. La boucle est bouclée.